
Par Harry Kampianne
Installée dans son grand loft lumineux aux portes de Paris, Françoise Maeght, plus connu sous le nom de Yoyo Maeght, petit sobriquet concocté par Jacques Prévert, un de ses « tontons » d’adoption avec qui elle échangeait régulièrement, nous dévoile sa saga familiale ponctuée de quelques éclats de rire parfois grinçants. La petite-fille de l’éditeur, galeriste et mécène Aimé Maeght, qu’elle aime encore appeler « papy » et qui créa en 1964 la Fondation Marguerite et Aimé Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, a tout conservé du principal trait de caractère de son grand-père : n’obéir à personne et suivre sa route. Aujourd’hui, commissaire d’expositions et auteur d’ouvrages sur l’art et sa famille, elle n’en révèle pas moins que même chez les Maeght, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Auriez-vous une définition à me donner sur ce qu’est « l’esprit Maeght » ?
C’est avant tout une manière d’être, déconnecter de la matérialité, ce qui peut paraître bizarre pour le marchand de tableaux et fondateur de la fondation qu’était mon grand-père. Je pense qu’on ne peut pas parler de « l’esprit Maeght » sans parler de spiritualité, sans que cela soit lié au religieux. Jacques Prévert qui était un anticlérical connu et reconnu a participé avec mon grand-père à l’élaboration de la fondation. Ils étaient tous les deux dans la même spiritualité. « L’esprit Maeght », c’est surtout l’aventure d’une collectivité d’artistes qui n’étaient pas forcément tous reconnus à l’époque. « L’esprit Maeght », c’est surtout un mélange entre l’histoire de l’art, le merveilleux, la religion, la littérature… Je me rappelle d’une très belle phrase que Braque disait à mon grand-père : – Est-ce que l’artiste a vingt ans d’avance ou le public vingt ans de retard ? –
Quelle est votre position par rapport à cet « esprit Maeght » ?
Je vis depuis ma plus tendre enfance parmi des artistes et dans le flux d’événements artistiques. Dans ce cas, c’est réaliste et non prétentieux de dire que je ne fais pas partie du grand public, et de l’autre côté, je ne fais pas partie des artistes. Je me vois plutôt comme une observatrice qui a la chance d’être au milieu des œuvres et de côtoyer la pensée des artistes qui peut nous faire avancer sur notre propre existence. Est-ce que je dois jouir de ce privilège ou est-ce que le minimum n’est pas de faire profiter de cette chance au plus grand nombre ? Je crois que c’est çà aussi « l’esprit Maeght ». Se tenir informer et informer les autres. La fondation est avant tout un outil au service des artistes.

Charlie Chaplin, Jacques Prévert et Georges Braque lors d’un dîner de gala à la Fondation Maeght ©André Pic

Georges Braque, Marguerite Maeght et Joan Miró ©Archives Maeght

Aimé Maeght et André Breton, exposition «Le surréalisme» en 1947, organisée par Breton et Duchamp à la galerie Maeght. © Archives Maeght

Aimé Maeght arrivant à New York en 1956 ©Archives Maeght



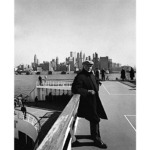
Dans « Maeght – l’avenir de l’art vivant » (publié en 2006 aux éditions La Martinière), vous dites – mes sœurs et moi n’avions pas besoin de rêver aux princes charmants tant nous étions entourés d’êtres exceptionnels. Qu’est-ce qui vous attirait chez eux ?
La place qu’ils nous laissaient pour notre imaginaire. Je veux dire par là que leurs imaginaires à forger notre imaginaire. Quand vous regardez un tableau de Chagall avec une chèvre bleue qui vole dans le ciel au-dessus de la Tour Eiffel et un âne rouge ainsi qu’un violoniste et un clown la tête à l’envers, ça laisse une place à votre imaginaire bien supérieur au Magicien d’Oz, à Blanche-Neige ou n’importe quel autre dessin animé. C’est la même chose avec un tableau de Miró. Ces êtres exceptionnels nous ont donné à « lire » la beauté.
Quel sentiment éprouviez-vous lorsque vos parents vous disaient que vous étiez un enfant trouvé ?
C’est Prévert, un ami très proche de mon grand-père, qui a trouvé cette formule à proposer à mes parents parce qu’ils me trouvaient moche : – Tu n’as qu’à dire que c’est une enfant trouvé –
C’est un peu cruel comme humour d’autant que vous y avez cru jusqu’à vos dix ans.
C’était une autre époque. On sortait de la guerre et les gens se forgeaient une résilience à leur mesure. Prévert était un dadaïste avec un humour noir voire grinçant qui n’est quasiment plus possible de nos jours. Il nous aimait à sa façon en nous racontant à mes sœurs et moi souvent des histoires de monstres avec des gorgones, des êtres surnaturels qui nous faisaient peur et on adorait ça. J’avoue que ce n’était pas facile pour une jeune fille de penser être une enfant adoptée. La blague aurait pu s’arrêter au bout de deux ou trois jours mais mes parents n’en ont pas prit conscience. Ils étaient dans leur monde jusqu’à ce que je leur pose réellement la question. Ils ne pensaient pas à mal mais selon mon père un enfant ayant le cul propre et le ventre plein ne peut pas être malheureux.
Justement avec le recul aujourd’hui, pensez-vous que vous n’avez pas lieu de regretter l’attitude vous parents ?
On ne manquait pas d’amour. Celui de notre grand-mère (Marguerite Maeght) était expansif alors que mon grand-père n’avait rien du papy gâteau/câlin mais il nous valorisait et puis tous les artistes qui collaboraient avec lui, c’étaient en quelque sorte nos oncles de substitution. Pour moi, Miró c’était mon tonton chéri. Lors de la dernière exposition de son vivant à la galerie (ndlr : la galerie Maeght, rue du Bac à Paris, inaugurée en 1945), il présentait des céramiques en vitrine et comme on ne pouvait pas tourner autour, je lui ai proposé de mettre un miroir derrière. Il m’a répondu – la lune n’a d’intérêt que si on la voit une face à la fois – J’ai trouvé cette réponse magique et du coup, elle me sert tous les jours. Une phrase comme, ça décuple votre imaginaire. Elle incite à la réflexion.

Face à cette multitude d’oncles de substitution, il y avait aussi des fortes tensions entre vos grands-parents et vos parents.
Je pensais qu’avec la disparition de papy, ce ressenti aurait disparu. Mais mon père (Adrien Maeght) a été un peu formaté dans cette histoire. Papy a eu une maîtresse pendant douze ans. Il n’avait rien d’un coureur de jupons ou d’un harceleur, beaucoup de gens qui l’ont côtoyé de près sont formels là-dessus, mais le fait d’avoir une maîtresse attitré pendant autant de temps a été une souffrance terrible pour ma grand-mère. Elle ne pouvait pas se venger de lui et encore moins quitter un homme aussi inventif, excessif, passionnant et charismatique que mon grand-père. C’était un personnage hors norme. Il a inventé son propre style.
On a l’impression lorsque l’on découvre des portraits de votre grand-père sur de nombreux documents qu’il y a une certaine retenue chez lui.
C’est vrai. Papy avait un côté pudique. Il pouvait être très chaleureux voir grande gueule, et en même temps n’accorder sa confiance que très progressivement à quelqu’un. Il avait un magnétisme à tel point que personne ne pouvait rester insensible. J’ai l’habitude de dire lorsque l’on me lance – c’est formidable que votre grand-père ait cru en tous ces artistes – je leur réponds – vous ne pensez pas que ce sont plutôt les artistes qui ont cru en mon grand-père ?
D’où l’existence de la Fondation ?
Il ne faut pas oublier que pour un artiste, confier son œuvre à un autre, pas seulement matériellement, mais aussi pour que celui-ci en parle, c’est au-delà de la confiance. Cela signifie une intimité d’esprit au quotidien. J’ai une cinquantaine de lettres entre mon grand-père et Miró où ils ne parlent que de travail. Le souci d’un artiste, ce n’est que son œuvre et le souci de papy, ce n’était que l’œuvre des artistes. Il a su rassembler des individualités différentes. Certains de ces artistes ont fait partie de mouvements importants. Il n’a jamais défendu une école ou un courant artistique mis à part peut-être la Figuration Narrative avec Valerio Adami. Le plus difficile, c’est de garder l’émerveillement et de ne pas être blaser. Papy, c’était un émerveillé permanent, Miró aussi. Ils m’ont appris à regarder. Les œuvres que les artistes ont conçu pour ce lieu sont nés de leurs émerveillements.

Depuis que vous avez été écartée de la Fondation en 2011 pour cause de discorde avec votre père et votre sœur Isabelle, pensez-vous que cet « esprit Maeght » est encore vivant ?
Non ni à la galerie, ni à la Fondation.
Pourtant cette aura, je parle de la Fondation, s’est perpétuée au-delà de la mort de votre grand-père à travers des personnages comme Jean-Louis Prat qui a été le commissaire incontournable de nombreuses expositions durant trente-cinq ans.
Jean-Louis, avec qui j’entretiens toujours de très bonnes relations, a été formé par mon grand-père. Je pense qu’il a beaucoup plus « l’esprit Maeght » que mon père. Il a su conserver cet engagement et ce lien fraternel qu’avait papy auprès des collectionneurs et des artistes. D’ailleurs, il a démissionné en 2004 pour de nombreuses divergences en matière de programmation avec mon père et ma sœur Isabelle. Il n’avait plus la liberté et la confiance absolue que mon grand-père lui avait accordé. Actuellement, il n’y a plus vraiment de directeur artistique. Celui qui est en poste aujourd’hui (Frédéric Hubin) est un ancien directeur de la com, du mécénat et du développement. Ce n’est pas un historien de l’art. Il n’a aucune connaissance approfondie du monde des collectionneurs et des grandes rétrospectives.
Vous pensez que votre père et votre sœur se sont complètement détournés de l’engagement de votre grand-père ?
Oui et je ne leur en veux même pas. Ils n’ont pas compris ce qu’était « l’esprit Maeght ». Quand il y a eu des hommages à René Char, Pierre Reverdy, Malraux ou Prévert, il me paraissait impensable d’exposer « Aventures de la Vérité » (2013) de Bernard-Henri Levy. Quels sont ses liens avec l’histoire de l’art, la défense d’artistes décriés, les collectionneurs. On ne lui connaît pas d’écrits engagés sur l’art. Bernard Henri-Levy est avant tout un individualiste. Il ne sert pas la Fondation, il se sert de la Fondation. Ce n’est pas la même histoire. Pour résumer l’éthique de ce qu’est « l’esprit Maeght » à travers l’engagement de mon grand-père, je dirais – Je fais ce en quoi je crois, je ne l’impose pas mais je l’apporte aux autres – La Fondation n’est pas une vitrine de magasin.
À lire :
La Saga Maeght, éditions Robert Laffont
334 pages, 21,50 €
Fondation Maeght
www.fondation-maeght.com
Tél : 04 93 32 81 63


